
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation Nationale, a ensuite
rappelé qu’on ne peut pas abandonner nos enfants à des réseaux internet
qui fonctionnent parfois comme de véritables services de recrutement
sectaire. « Il faut lutter contre les préjugés » a-t-elle répété. Ces
préjugés colonisent les esprits des adolescents, comblent une quête de
sens ou une certaine inquiétude existentielle, et les incitent à
commettre l’irréparable.
Lutter contre les préjugés ? Pas si simple. On sent bien que les
efforts du gouvernement vont dans ce sens. Mais sera-ce suffisant ?
Certes, les mots comptent, les discours rassurent et désamorcent les
fantasmes ou les peurs. Mais les moyens mis en œuvre, complexes et à
l’épreuve de la durée, sont-ils à la mesure du défi ?
« Laïcité, autorité, fermeté», étaient les maîtres-mots du discours
de Manuel Valls à l’Assemblée nationale le 13 janvier dernier en hommage
aux victimes des attentats.
« Il s’agit de lutter contre les préjugés qui déconstruisent la
société française », a rappelé le Premier ministre. Ces préjugés sont
les stéréotypes et les clichés immondes, terreau de haine et de
division, qui se nourrissent du repli, de la discrimination et de
l’ignorance.
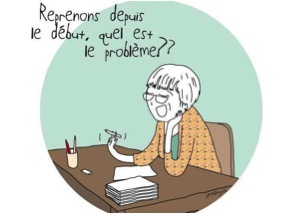
Tout le monde est d’accord sur ce point. C’est à l’école que les
préjugés doivent être combattus auprès de nos jeunes dont on a, sans
doute, négligé la formation de futurs citoyens responsables et fiers
d’appartenir à la nation. Ce sens du bien commun, de la solidarité et de
la tolérance, doit retrouver le chemin de l’école. Car « l’école, c’est
la République » a rappelé Manuel Valls.
C’est bien sûr dans l’unité et dans un ‘’esprit des lumières’’ que
les préjugés doivent céder le pas au sens critique et au goût du savoir.
Mais la tâche est immense. Le chef du gouvernement a reconnu que nous
avons derrière nous « les insuffisances et les échecs de trente ans de
politique d’intégration. »
Des dérives idéologiques
ont mis à terre les fondements traditionnels
et solides de l’école de la République.
Eric Zemmour nous rappelle dans son dernier livre Le Suicide français
(Paris, novembre 2014, pages 157-161) que la vague de « pédagogisme
intégrateur » a commencé avec la réforme Haby sur le collège unique en
1977. L’obsession progressiste des gouvernants de l’époque voulait
démocratiser l’école et la faire entrer dans la société moderne
c’est-à-dire la coller au plus près du modèle anglo-saxon où,
avouons-le, la rigueur des contenus disciplinaires est moins importante
que la créativité dite ‘’spontanée’’ des élèves.
On voit aujourd’hui les
conséquences de ces dérives idéologiques qui ont mis à terre les
fondements traditionnels et solides de l’école de la République.
L’école repose sur une double autorité qu’incarne l’enseignant :
celle du statut (garant de l’institution) et celle de la compétence
(chargé des apprentissages). A travers les savoirs enseignés, les profs
se réfèrent à des valeurs et à une éthique qui forment les élèves et les
responsabilisent (Colloque « Quelle autorité à l’école », Cahiers
pédagogiques 25 et 26 octobre 2004).
Dans la pratique quotidienne de la classe, les élèves doivent trouver
leur propre place dans la confrontation permanente entre l’intérêt
collectif et le besoin individuel. Quand ils prennent la parole,
interviennent, contribuent au cours, ils acceptent les règles du jeu qui
imposent des contraintes mais aussi des libertés et des droits, ils
sont déjà des citoyens à part entière.
Mais attention, pas d’utopie ni de démagogie ! Gare à l’idéal du tout
participatif laissant la part belle aux adolescents ‘’inventifs et
curieux’’, avides de partager et d’apprendre. Les « jeunologues » et
autres gourous du pédagogisme sont des fauteurs de troubles qui ont tué
l’école de la République. Moi je vois des élèves de plus en plus passifs
et consommateurs, attentistes et suspicieux. L’inclination naturelle et
bienfaisante au travail, à l’acquisition des méthodes et à
l’assimilation de nouvelles connaissances, se réduit comme peau de
chagrin.
La culture générale s’appauvrit, la propension à l’effort
disparait, les règles et les codes de conduite fixés par le règlement
intérieur des établissements sont contournés et de plus en plus mal
acceptés, y compris par les parents. L’obsession de l’égalitarisme a tué
l’école. L’exécration de l’élitisme l’a nivelé vers un bas
crépusculaire.
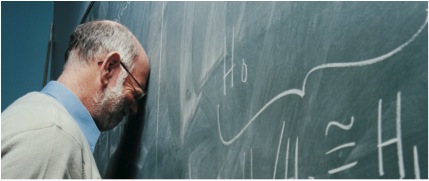
Le professeur a été dépossédé de sa place centrale dans le système
scolaire. Il doit pouvoir donner la parole, mais aussi contrôler
celle-ci et la maitriser. Il doit pouvoir incarner l’autorité, sans y
renoncer par découragement ou lassitude.
Pour lutter contre les
préjugés, l’école doit avant tout lui redonner confiance, pour le
réinvestir dans ce rôle indispensable qui est bel et bien celui d’un
formateur, d’un maître. Il s’agit de négocier sans s’enliser, de
convaincre sans punir, d’être ferme sans excès. Parler d’autorité c’est
d’abord l’incarner soi-même.
Si enseigner revient seulement à anticiper les désirs, les
attentes ou les interdits de nos élèves, et à livrer les contenus des
disciplines enseignées à leurs bons vouloirs, nous contribuons alors à
fragiliser nos traditions au risque de régresser culturellement.
Que dire de cette obsession consensuelle et de cette autocensure de
circonstance qui nous font souvent, dans nos cours, aborder les
programmes sur la pointe des pieds ?
Plus les élèves sont jeunes, plus les réactions sont vives et moins
le dialogue est facile. Cette tendance, assez nouvelle, est inquiétante.
Elle suppose que l’on vient à l’école non pour y découvrir des
connaissances et des vérités sur le monde que l’on n’a pas encore, mais
pour y voir confirmer des idées reçues et une vision simpliste de ce
même monde qu’on a déjà. Si le discours du professeur ne convient pas
aux élèves, ils le font savoir.
« Quand on dit des choses qui ne me
plaisent pas, ça m’énerve » m’a vivement rétorqué une élève de seconde.
Les préjugés commencent ainsi : une lecture univoque de la réalité qui exclut toute confrontation, tout débat, toute analyse.
Quand on est, par exemple, prof d’histoire dans un lycée de région
parisienne, on sait à quel point il existe des sujets de leçon qu’on
aborde avec difficulté.
Délicat de prononcer certains mots dans
certaines classes, au risque d’y voir flotter malaise et sourires
entendus dans le meilleur des cas, agacement voire franche hostilité
dans les pires.
Enseigner la Shoah est devenu un problème
bien plus qu’une solution
La guerre est déclarée quand vous prononcez les mots qui fâchent : juif, Shoah, Israël, conflit israélo-palestinien. Même
en affichant une précautionneuse neutralité, même en s’en tenant à une
factualité acceptable et objective, on avance sur un fil, scruté de
près.
Alors que l’on vient de commémorer la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, comment ne pas y réfléchir ?
Enseigner la Shoah est devenu un problème bien plus qu’une solution.
Le signal d’alarme lancé ces dernières années par d’éminentes
personnalités, dont Claude Lanzman (Le Monde, 30 août 2011), n’a pas été
entendu. Les enseignants peinent de plus en plus à enseigner la Shoah « face aux attitudes réfractaires de leurs élèves »
Le chef du gouvernement l’a rappelé sans mâcher ses mots dans son discours du 13 janvier dernier :
« Le
premier sujet qu’il faut aborder clairement, c’est la lutte contre
l’antisémitisme (…) né dans nos quartiers, sur fond d’Internet, de
paraboles, de misère, sur fond des détestations de l’État d’Israël, et
qui prône la haine du juif et de tous les juifs (…) Comment on peut
accepter qu’un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant quand il lui
pose la question ‘’quel est ton ennemi ?’’ et qu’il lui répond ‘’c’est
le juif’’ ? »
Le Premier ministre a courageusement fait le constat lui-même : « La
République n’est pas possible sans l’école, et l’école n’est pas
possible sans la République. Et on a laissé passer trop de choses dans
l’école. »
L’école ne fera pas de miracles. Il lui faudra beaucoup de temps et
de courage pour lutter contre ces ‘’antivaleurs’’ qui la menacent d’une
débâcle sans précédent.
Alors que leur moral est au plus bas, les profs sont 54% au bord du
burn out, 40 % se sentent délaissés par leur hiérarchie, 68 % ont déjà
pensé changer de métier, 37 % ont été victimes d’insultes, 51 %
déconseillent à leurs enfants de faire le même métier (sondage Ifop paru dans le Huffington Post, 18 juin 2014) … Que faire pour arrêter l’hécatombe ?
Peut-être cette école a-t-elle failli par faiblesse et impuissance.
Peut-être devra-t-elle avant tout remettre en question ses propres
certitudes, ainsi que les doctes injonctions de ses experts qui, ici
pédagogues, là universitaires, ont distribué en cadence réformes et
circulaires au gré de leurs envies ou de leurs caprices.
Pour lutter contre les préjugés de nos élèves, l’école doit
d’abord affronter ses propres préjugés qui l’ont conduite à l’échec de
sa mission. L’école n’est pas victime de cet échec, elle en est aussi
responsable. Elle devra remettre au cœur du système les professeurs
eux-mêmes qui, sur le terrain et au jour le jour, cernent mieux que
personne les vrais problèmes et comprennent les vrais enjeux.
Les enseignants ont besoin de respect et de pouvoir. Démunis de l’un comme de l’autre, ils baissent les bras à leur tour.
Qu’on se le dise une fois pour toutes. Ce sont les enseignants qui
sont au cœur du système scolaire. C’est leur honneur et leur image qui
est au centre de l’institution républicaine.
Restaurer l’école, c’est
d’abord restaurer la place de ces enseignants, leur donner les moyens de
l’autorité, de la fermeté et du « feu ardent » qui légitime et renforce
leur vocation à transmettre et à former.
Jean-Paul Fhima