Les Juifs du Brésil auraient joué dans l’esclavage un rôle important, déterminant disent certains. Qu’en est-il vraiment ?
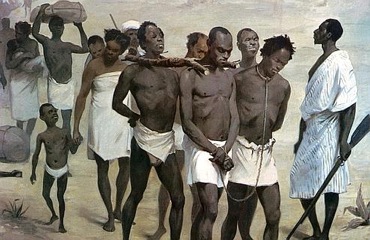
lire la suite dans Tribune juive
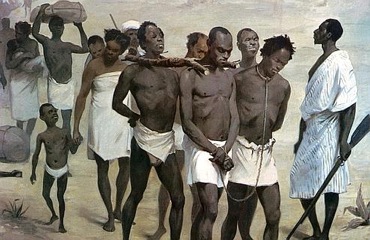
Alors que la France commémorait, le 10 mai dernier, l’abolition de
l’esclavage et que le Brésil est, pour un long mois de fête sportive et
populaire, le centre du monde entier, il n’est pas inutile de revenir
sur le sujet.
S’il faut rappeler d’abord les faits avec lucidité et autocritique,
il s’agit aussi de combattre une vision sélective et orientée qui
détourne la vérité historique pour en faire une propagande antijuive.
Le Brésil est longtemps resté un pays d’esclavage continu (de 1550 à
1850), massif (4 millions d’esclaves africains) et tardif (abolition en
1888).
Les esclaves noirs du trafic transatlantique venaient du golfe de
Guinée, d’Afrique centrale (Congo, Angola), du golfe du Bénin et
d’Afrique de l’Est (Mozambique).
Légitimé et réglementé par l’Eglise apostolique et romaine, c’était
d’abord une affaire de Chrétiens. Les bulles papales d’Eugène IV (1445)
et de Nicolas V (1454) ont autorisé puis confirmé l’esclavage dans les
colonies portugaises du Nouveau Monde.
« Le Christianisme est une religion esclavagiste » (Charlotte de Castelnau-L’Estoile, historienne spécialiste du Brésil).
Avant toute chose, rendons aux papes ce qui leur appartient.
Les faits.
A la suite de leur expulsion d’Espagne (1492) puis du Portugal
(1497), beaucoup de Juifs se sont convertis au christianisme mais ont
continué en secret la pratique du judaïsme. Ces convertis (conversos) ou
Nouveaux Chrétiens (cristãos novos), appelés aussi marranes, ont migré
dès la première expédition du navigateur Cabral (avril 1500) vers le
Brésil qu’ils ont contribué à découvrir, conquérir, exploiter et
développer.
Bien intégrés dès le XVIème siècle, ils sont d’honnêtes artisans ou
négociants, fonctionnaires, juristes ou militaires, riches planteurs
coloniaux de canne à sucre, mais aussi trafiquants ou bandits, avec pour
seul lien identitaire la fidélité (cachée ou non) à leur foi juive.
En 1630, la Hollande en guerre avec le Portugal conquiert les
comptoirs commerciaux du Nord-Est. Dès lors, Juifs hollandais et
portugais contribuent activement au commerce dit triangulaire pour la
compagnie des Indes occidentales.
Les conversos confirment leur rôle d’élite sociale, étendent leurs
droits et retournent officiellement à la religion juive. A Recife, ils
construisent la première synagogue du Nouveau Monde (Kahal Zur Israel),
une école Talmud Torah, un centre d’étude de la Gemara, un fonds de
bienfaisance, des routes, des ponts et même un système d’égout. En 1645,
selon l’historien hollandais Franz Leonard Schalkwijk, il y a autant de
Juifs à Recife qu’il y en a à Amsterdam, au pays tolérant de Spinoza.
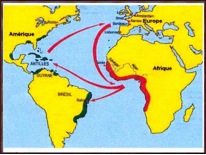 | ||||
La traite des noirs dit commerce triangulaire
En janvier 1654, les juifs hollandais sont officiellement expulsés.
Si plusieurs s’installent dans les îles Caraïbes ou migrent vers la
Nouvelle Amsterdam (future New York), beaucoup préfèrent rester au
Brésil quitte à abandonner de nouveau leur foi. Poursuivis par
l’Inquisition, plusieurs centaines de marranes dont les biens ont été
confisqués, sont renvoyés à Lisbonne, jugés et exécutés en autodafé.
Dans un livre retentissant intitulé Les Juifs et le judaïsme aux Etats-Unis, une histoire documentée (New York 1983), le rabbin Marc Lee Raphael, historien de l’histoire juive, évoque le cas des Juifs du Brésil :
« [A] Récife [il existait] une imposta (taxe juive) de 5 Soldos pour
l’achat de chaque esclave nègre par les Juifs brésiliens achetés auprès
de la Compagnie des Indes. Les ventes aux enchères d’esclaves étaient
reportées si elles tombaient au moment d’une fête juive. »
Les conséquents travaux de spécialistes réputés comme Arnold Wiznitzer (Jews in Colonial Brazil, New york, 1960) et Seymour Liebman (Jews and The American Slave Trade,
New York, 1965) confirment cette vérité historique. Indéniablement, les
Juifs ont pris une part active dans le commerce transatlantique des
esclaves africains.
Il est toutefois nécessaire de contextualiser ces éléments et d’en
désamorcer l’usage détourné qui en est fait … par les militants
antisionistes qui se jettent sur la ‘’bonne nouvelle’’ comme des
abeilles sur un pot de miel.
Dans le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme (version abrégée de l’Encyclopaedia Judaica), on peut lire à l’article Esclavage :
« La pratique de l’esclavage cessa chez les juifs beaucoup plus tôt
qu’elle ne fut abandonnée par les chrétiens ». Les activistes antijuifs
ne sont pas d’accord.
Le fantasme.
Si l’esclavage est une donnée de l’histoire universelle qu’il est
utile d’apprécier avec la neutralité qui s’impose, dans le cas des Juifs
elle deviendrait un crime singulier et impardonnable. Et surtout
l’argument infaillible pour affirmer que le sionisme en est la
continuité.
Loin de la rigueur scientifique et du débat d’idées, cette démarche
qui n’a rien d’historique a pour seul but de justifier
l’instrumentalisation antisémite et politique.
Israël Shahak, de l’Université Hebraïque de Jérusalem, ami de Noam
Chomsky et de Michel Warschawski, voit dans le rôle joué par les Juifs
dans l’esclavage du Brésil un avant-goût de la politique israélienne
d’aujourd’hui. Dans son sulfureux livre Histoire Juive-Religion juive
(1994), ce chimiste de formation, historien amateur, piètre théologien
mais excellent professionnel de la provocation radicale de l’ultragauche
israélienne, affirme qu’il y aurait dans le judaïsme et la Halakha (Loi
juive) une « abondance d’ethnocentrisme, de haine, de mépris [et] de
chauvinisme ». Se disant lui-même contre « l’oppression des
Palestiniens », il voit dans l’esclavagisme une raison de plus de
condamner la politique de l’Etat d’Israël qu’il qualifie d’
« antihumaine et raciste ».
C’est la théorie simplissime du ‘’ceci
explique cela’’.
La participation des Juifs dans la traite négrière atlantique est
attestée jusqu’au début du XVIIème siècle puis décline quand
l’Angleterre et la France ont le droit de vendre des esclaves dans les
colonies d’Amérique et des Caraïbes. Les Juifs n’auraient pas participé
de manière significative à l’apogée du commerce mondial des esclaves,
lequel se situe plutôt aux XVIII-XIXème siècle.
lire la suite dans Tribune juive